Cette série de peintures diffère assez de ce qu'il peut faire habituellement, mais je dois dire qu'elles m'ont littéralement scotchée : je suis restée devant de longues minutes, à regarder les expressions des visages, les regards, et à chercher à comprendre ce que ces enfants avaient vu. (n'hésitez pas à cliquer sur la photo de la série puis à zoomer pour mieux appréhender ce qu'elle dégage)
Voici ma réponse.
Jamais je n'aurais cru repasser par ce village un jour. Parce que je ne suis pas du genre à me retourner, depuis fort longtemps.Peut-être aussi un peu par lâcheté. J'ignore ce qui m'a pris. Le travail m'avait amené à une dizaine de kilomètres de là, et après le déjeuner et un joli contrat signé avec mon client, en reprenant la carte routière, ce nom m'a sauté aux yeux. Dompierre. Le village de mon enfance. Blanche... Françoise... Mes amis égarés.
En une poignée de secondes ma décision était prise. J'ai pris la D21 et j'ai roulé jusqu'à la Grand place. Elle avait été refaite : plus trace du terrain de boules à présent, mais un parking avec des places soigneusement délimitées par des bandes de peinture blanche. Je me suis garé là et je suis monté directement au cimetière. Je n'avais pas spécialement envie de revoir le reste du village ni les changements opérés en près d'un demi-siècle. Je voulais juste revoir Françoise.
J'ai retrouvé sa tombe assez facilement. Françoise Lecoq, 12 février 1945 – 24 juin 1962. Il y avait toujours sa photo dans le médaillon ovale, mais le temps l'avait presque effacée. On discernait pourtant toujours ses yeux rieurs et sa petite bouche laquée de rouge qui ressemblait à une cerise. Elle était si belle, si jeune encore. Je l'ai regardée longtemps, longtemps, et la photo a fini par grandir et m'engloutir. Je me suis retrouvé presque cinquante ans en arrière.
Le jour de la Saint-Jean, dans le champ du vieux Henri.
Il avait été moissonné deux jours plus tôt pour l'occasion et la fête se déroulerait ici. Les tables du banquet étaient déjà dressées, les nappes blanches voletaient mollement dans la brise, et les guirlandes finissaient d'être accrochées par les volontaires endimanchés. J'avais douze ans, mon certificat d'études en poche, et j'étais bien décidé à déclarer ma flamme à Blanche ce soir-là, pendant le bal. En attendant la complicité de la nuit et d'un verre d'alcool que je parviendrais à chiper sur une table, je la regardais tresser les cheveux de sa sœur Daphné. J'admirais ses yeux très noirs, son port de tête altier, ses petites dents blanches qui semblaient briller lorsqu'elle partait d'un grand éclat de rire.
Nous avions décidé d'organiser une course en sac. Il y avait là toute la petite bande. Mon meilleur ami Maurice, avec ses deux petits frères, René et Pilou. Antoine et Gabrielle, les enfants de Denise, qui tenait la mercerie au coin de ma rue. Et puis les deux « grands » de la bande, Bernard et Marcel, tous deux partis en internat, et qui ne revenaient que pour les vacances. Je voyais bien que Blanche n'avait d'yeux que pour Marcel tandis que chacun grimpait dans son gros sac de jute. Cela me pinçait un peu le cœur, mais il fallait bien admettre qu'il en jetait, avec sa belle chemise et ses cheveux plaqués sur le côté.
Nous nous mesurerions quatre par quatre. Les premiers concurrents étaient Marcel, Antoine, Gabrielle et Pilou, qui nageait dans son sac mais semblait prêt à en découdre.
Nous les attendions sur la ligne d'arrivée, Blanche étant chargée de donner le signal du départ en abaissant son mouchoir. Marcel prit rapidement de l'avance, mais un trou qu'il n'avait pas vu le jeta à terre. Malgré le pincement de lèvres de Blanche, ou peut-être à cause de celui-ci, je ne pus réprimer un sourire de satisfaction. Antoine et Gabrielle passèrent devant lui, au coude à coude, et ils n'étaient plus très loin de la ligne d'arrivée lorsque nous entendîmes la voix fluette de Pilou : « Jusqu'à la forêt ! Allons jusqu'à la forêt ! » Il espérait ainsi rattraper son retard, et les trois grands crièrent « D'accord Pilou, jusqu'à la forêt ! », tout en ralentissant un peu pour le laisser regagner du terrain.
Blanche riait aux éclats en regardant Pilou se démener comme un beau diable, et nous l'encouragions tous de nos cris et nos battements de mains. Tout occupés à l'observer, nous ne vîmes pas que les trois autres concurrents s'étaient arrêtés à quelque mètres de la forêt. J'avais couru à côté de Pilou pour l'encourager, tandis que les autres nous rejoignaient en marchant nonchalamment. Je ne vis pas tout de suite ce qui avait arrêté les trois premiers. Je fus d'abord alerté par le visage de Gabrielle, figé, bouche ouverte.
Elle ne bougeait pas plus qu'une statue, la main droite encore agrippée au sac, la gauche arrêtée en l'air, doigts crispés. Antoine écarquillait les yeux, souffle court, cheveux trempés de sueur. Quant à Marcel, il demeurait lui aussi bouche ouverte, ses bras tenant le sac plaqué contre lui comme un rempart, mais tellement silencieux que d'un geste instinctif j'arrêtai Pilou en étendant le bras devant lui. « Qu'est-ce qu'il y a ? demanda-t-il, pourquoi on arrête ? ». Mes yeux glissèrent lentement en direction du point fixé par les trois autres. Je vis d'abord, dans le fossé séparant le champ de la forêt, un soulier rouge vif accroché à une branche qui traînait là. À deux mètres de lui, son double, encore bien attaché à la cheville par un lien de satin pourpre. Le bas de la robe rouge à pois blancs était relevé presque jusqu'au front, si bien que je ne reconnus pas immédiatement la jeune fille qui semblait s'être endormie là. Seules ses mains témoignaient de la lutte, le bout des doigts abîmé et noirci de terre. À côté de ses cheveux roux éparpillés brillait une pince argentée à breloques rouges.
« Mais pourquoi on arrête ? » répéta Pilou qui, trop petit pour apercevoir le fond du fossé et toujours bloqué par mon bras, n'avait rien vu. Marcel rompit le silence. Il connaissait bien Françoise, le sœur de Bernard, dont il était secrètement amoureux. Il l'avait déjà vue maintes fois avec cette pince à cheveux dont elle était si fière. De sa bouche ouverte sortit enfin un cri. « Bernard ! Viens vite ! C'est ta sœur... » Le ton était sans équivoque. Bernard se mit à courir vers nous, un doigt menaçant levé en l'air. « Je te préviens que si tu parles mal de ma sœur, Marcel, je t'en fous une ! », mais déjà sa voix tremblait, ses traits se déformaient, et sans vraiment savoir, il savait.
Les autres nous rejoignirent juste après Bernard. Nous demeurâmes immobiles et muets quelques secondes, hormis Pilou qui continuait de demander pourquoi on arrêtait la course. Blanche souffla « Il faut aller le dire... Il faut... On court ! »
Et soudainement l'urgence nous prit, même s'il était de toute évidence trop tard. Nous partîmes d'un seul bloc en direction du vieux noyer à présent tout décoré de lampions colorés, et nous courûmes, à toutes jambes, comme si notre propre vie dépendait de l'énergie que nous mettrions dans cette course. L'image de Blanche courant ce jour-là est restée gravée en moi. L'étoffe blanche de sa robe qui se tendait sur ses cuisses, sa queue de cheval qui fouettait sa nuque, et moi à sa hauteur, haletant, la regardant avec une telle souffrance, comme si j'avais immédiatement compris que la fête serait gâchée à jamais et que nous avions perdu au bord de ce fossé tout un pan de nous-même.
Officiellement, on ne sut jamais ce qui était arrivé à Françoise. On a raconté bien des années plus tard qu'un des trois frères Bazin, un soir de beuverie ordinaire, aurait laissé échapper quelque chose à ce sujet, mais que les deux autres l'avaient fait taire d'un coup de poing bien senti et ramené chez eux manu militari.
Pour ma part, je montrai à partir de ce jour de moins en moins d'enthousiasme à rentrer du collège pour les vacances, et dès que cela fût possible, je ne revins plus du tout à Dompierre. Mon enfance et mon innocence gisent encore quelque part, là-bas, au bord d'un fossé.
Ce jour-là, au cimetière, j'ai pu les pleurer pour la première fois.
J'en étais là lorsque des bruits de pas sur le gravier m'ont tiré de ces souvenirs. La personne s'est arrêtée juste à côté de moi. Étonnamment, je suis resté les poings serrés au fond des poches, sans bouger. Quelque chose me vissait le regard sur la photo fanée, sur ces yeux rieurs et cette bouche comme une cerise.
C'est elle qui a fini par rompre le silence. « Je viens la voir chaque mois. Ça me donne l'impression de réparer quelque chose, d'effacer un peu de l'oubli dans lequel elle est tombée. Tu sais, les frères Bazin sont morts tous les trois, il y a sept ans. Un incendie dans leur ferme, pendant qu'ils dormaient. Personne ne les a pleurés, va... C'est drôle, je t'ai reconnu immédiatement lorsque tu es passé devant chez moi. J'étais sûre de te revoir un jour, Paul. Sûre que tu reviendrais... Tu as le temps de venir boire un café avec moi ? »
Mes mains se sont ouvertes au fond de mes poches, ma tête s'est débloquée d'un coup, et je l'ai enfin regardée. Ses cheveux étaient attachés en un chignon haut et un peu lâche, quelques mèches s'en échappant et retombant sur sa nuque. Elle avait gardé les mêmes yeux très noirs, le même port de tête altier.
J'ai souri. « J'ai le temps, oui... J'ai le temps. »
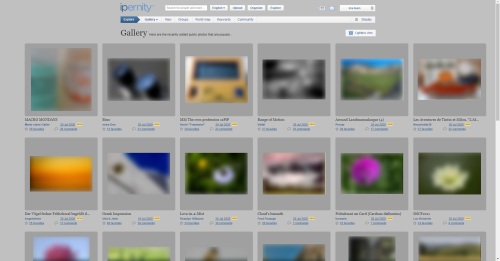





Sign-in to write a comment.